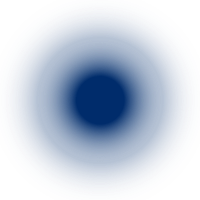L’installation Le solstice des baleines ne s’est jamais ancré dans le Saint-Laurent. Cependant, par le récit que Reno Salvail nous a livré, il a mis au monde une autre œuvre qui, a-t-il écrit, amenait « les spectateurs au seuil d’une ambiguïté les faisant osciller entre rêve et réalité, fiction et récit autobiographique ». Autrement dit, Le solstice des baleines est une œuvre qui s’est concrétisée par le truchement de notre imagination.
Ce fantasme ou, peut-être plus justement, cette vision est devenue l’obsession, depuis quelques années, d’Alain Lefort. À travers le filtre de sa créativité et de son engagement, Le solstice des baleines a évolué vers L’aube du solstice, une nouvelle œuvre chargée de réaliser la précédente afin de nous permettre, pendant un bref instant, de baigner dans un rêve aussi simple que grandiose.
Or, si le projet se circonscrit à une date, une heure, tout au plus un moment, il était clair pour Alain Lefort que le chemin pour s’y rendre était tout aussi précieux. Sur celui-ci, des gens créatifs et illuminés ont partagé leur savoir, leur compétence, leur cœur, leurs angoisses aussi devant ce monde qui vacille sur ses assises, avec pour espoir d’engendrer et de rendre compte de la beauté du vivant.
En somme, si L’aube du solstice, à l’instar du Solstice des baleines, n’avait pu se concrétiser, entravé par un vent mauvais, une pluie torrentielle ou d’incontrôlables feux de forêt, l’espoir qu’il aurait fait naître aurait été, en soi, une réussite. Mais voilà : L’aube du solstice a eu lieu. Le soleil s’est levé sur Grande Basque et nous y étions, dans le secret du Saint-Laurent, privilégiés et miraculés, attentifs aux beautés d’une vie en éveil.
La dernière traversée
Il est environ minuit quand nous prenons le large. Les berges illuminées de Sept-Îles d’un côté et, de l’autre, la noirceur opaque de la mer, dans laquelle nous nous engloutissons, avec la certitude d’y voir bientôt surgir la lumière. Après une dizaine de minutes de navigation, déjà, nous approchons de Grande Basque, longeant ses côtes en ajustant notre tracé à son pouvoir attractif, tout en gardant une certaine distance pour éviter les hauts-fonds.
Bientôt, on entre dans un sanctuaire cerclé de quatre îles – Grande Basque, Petite Boule, Grosse boule et Petite Basque –, plus noires encore que la nuit, mystérieuses et impressionnantes, par leur façon obstinée de résister au règne de l’eau. Enfin, le bateau bifurque à tribord et pénètre l’enceinte de cette scène qu’Alain Lefort décrit comme « un amphithéâtre romain naturel ».
Les trois tours gardent la pose et nous accueillent sans broncher. Charriant le matériel nécessaire à l’événement, nous bondissons de pierre en pierre jusqu’au plateau rocheux qui accueillera bientôt la performance d’Alissa Cheung. Nous sommes sur scène, donc, et pourtant le spectacle est tout autour. Le ciel triomphant, couronné d’une voie lactée et d’étoiles qui nous offrent un infini vertigineux et, surtout, la promesse d’un horizon dégagé. La mer, opaque et profonde, étend son empire sur la vie qu’elle couve, frappant avec entêtement le mirage des îles qui en émergent, plus loin. Dans un silence camarade et intime, nous attendons.
21.6.2023
Il est à peine 2h30 lorsque nous croyons entendre le murmure de Jacques Prévert :
« Et comme la nuit au doux visage de lune
tente de s’esquiver
furtivement
le prodigieux clochard au réveil triomphant
le grand soleil paillard bon enfant et souriant
plonge sa grande main chaude dans le décolleté de la nuit
et d’un coup lui arrache sa belle robe du soir. »
Là-bas, par-delà Sept-Îles, plus loin encore qu’une forêt aussi puissante que vulnérable, là où la Terre ploie dans l’horizon en conférant la victoire au ciel, la noirceur s’est bleutée. Ce n’est pas encore une lueur, mais on sent le soleil reprendre du terrain. Il est là, de moins en moins lointain, avec son armée grondante de lumière, prêt à nous rejoindre.

Doucement, presque insidieusement, la noirceur s’efface peu à peu. Le soleil est un germe qui émerge de terre, éclatant et neuf, et une masse nuageuse dessine des silhouettes sur cette page blanche. Ils sont là, Don Quichotte à cheval et Achab, perché au-dessus de la mer, prêt à y abandonner son âme. Juste avant de se dissoudre, d’un geste de la main, ils annoncent le début de l’événement.
Quelques bateaux arrivent, cisaillant la mer dans un flottement délicat et résistant avec grâce à la puissance de l’eau. Graduellement, notre groupe devient une petite communauté, faisant éclabousser quelques éclats de voix et de rires. Puis, les étincelles de ces petits chocs humains s’éteignent et le silence reprend l’estrade.
Alain Lefort, de sa voix déjà enregistrée, nous offre un mot, dans lequel il nous invite à la somme d’un rêve qui l’a habité avec tant de force qu’il lui a permis de rapailler ciel et mer, artistes et communautés. En arrière-scène, sur le point qui offre le plus beau panoramique de ce théâtre, il est là, parmi nous, qui accueille la lumière, son appareil photo glissé dans sa main comme une extension de son bras, tandis que sa voix harangue les baleines : « Je me suis un peu approprié ces baleines à force de les pourchasser… Tant et tellement que je les voyais dans ma soupe. Si l’une d’elles se montre, ne serait-ce qu’un souffle d’évent, ça sera assez pour couper le mien. Mais tout comme le soleil, elles sont là. Peut-être dans les abysses du Fleuve ou un peu plus loin au large. Peu importe, elles vivront le même instant que nous. Avec nous. »
Quelques oiseaux viennent fouiner dans notre coin, nous contemplant de haut en chantant des mélodies connues. D’autres, moins gênés, flânent dans notre amphithéâtre, profitant de billets gratuits, attirés par ce spectacle étonnant : des humains massés sur les rives de Grande Basque, des bateaux à l’arrêt dans la crique, des tours, comme des phares, dont la présence singulière et le clignotement lumineux semblent donner un signal, et toutes ces caméras, perchées à flanc de récif, entre deux crevasses, qui braquent le ciel, la mer et cette femme, debout sur une scène sculptée par le vent et le ressac de l’eau depuis des millénaires.
Alissa Cheung débute sa composition, nous invitant sous l’eau, dans une bulle assourdissante, bercée par le chant des baleines. Sommes-nous encore sur terre ou dans un ailleurs, flottant à la rencontre d’univers concomitants? On se croirait dans un rêve. Le temps se dissout, notre attention se disperse. On l’avait oublié, mais le lever du soleil est une drogue qui décuple nos sensations.

La musique d’Alissa Cheung multiplie les immersions et nous partons en voyage sur la portée de sa composition : les chants de baleines deviennent des boucles qui rappellent le décollage d’un avion; des dauphins arrivent, leurs clics sont un langage qui se déploie comme notre langue sur un clavier; la caresse de l’eau se sédimente et devient pluie – ou est-ce plutôt le crépitement d’un feu? Autour, le vivant ajoute ses trames : le ressac de la mer, le chant des oiseaux et le souffle délicat du vent.
Le soleil irradie l’horizon, mais son noyau demeure caché par des amas de nuages, qui profitent de l’éclairage pour jouer un théâtre d’ombres. Ils sont autant de territoires imprenables qui dessinent notre imagination, se forment et se défont. La mer, étale, semble elle aussi apaisée par ce moment d’arrêt, à peine soufflée de quelques vagues qui ne laissent même pas surgir des moutons d’écume. On embrasse sa quiétude, on espère des baleines, et la musique, justement, après une douce balade de guitare, nous rappelle aux chants de rorquals.
Les tours ne clignotent plus, s’accrochant à la lumière de leur projecteur pour attirer celle, suprême, du soleil. Le ciel est une déclinaison rosée, une chair juteuse d’agrume. Le grand astre se cache toujours, mais on le voit qui grimpe dans la hiérarchie du ciel, quelques-uns de ses rayons perçant des trous dans des nuages haut perchés.
Dans l’éclat frais du jour nouveau, la végétation de l’île s’étire vers le ciel, comme pour chasser la rouille de la nuit. La mousse verdoie, les arbustes tendent l’oreille au vent et quelques conifères règnent sur l’île, fièrement debout. Le ballet nuptial des baleines se poursuit sous la gouverne d’Alissa Cheung, et on peut deviner, au loin, leur danse maintenue secrète.
La musique en est à ses dernières mesures, prêtes à concéder le plancher aux animaux qu’elle venait de célébrer, lorsqu’un soleil triomphant perce les nuages, enfin hissé dans un ciel qu’il avait d’abord réchauffé. Ses rayons irriguent la surface de l’eau et remontent jusqu’à nous, achevant de nous éveiller. Nous craignions qu’il n’y arrive pas, mais c’est que nous sommes égoïstes et anxieux de nature. Nous sommes redevables d’un système duquel il est le maître, et il allait de soi que le dernier mot lui appartienne.

Et c’est ainsi, entre sa puissance et celle des baleines, que nous demeurons, encore un moment, suspendus. L’aube du solstice a eu lieu et, sous nos yeux, un générique vivant défile, retenant notre souffle encore un peu, avant que nos vies reprennent leur chemin. Bientôt, pas à pas, souffle après souffle, une note à la fois, nous reprendrons la spectaculaire marche du jour, célébrant notre place dans le royaume des vivants.
D’ici là, encore entre deux mondes, notre souveraineté est sous tutelle et nous appartenons encore à l’aube. Nous nous reconnaissons dans ce qui nous entoure. Nous sommes une île, mais nous sommes aussi cette eau qui nous encercle. Nous sommes cette chaleur qui irradie notre chair. Nous sommes cette terre qui nous a pétris. Nous sommes un chant d’espoir. Enfin, nous renaissons à nous-mêmes. Et encore, nous sommes vivants.